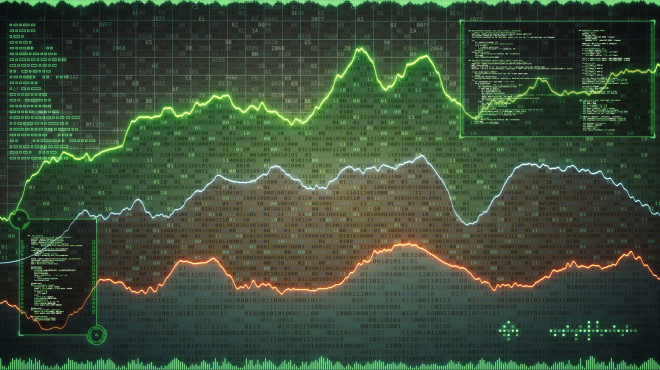La Chine est-elle responsable du déficit de la balance commerciale des États-Unis?
Le déficit de la balance commerciale des États-Unis pourrait se résorber si les Américains consommaient moins et que l’État dépensait moins. Mais comme les États-Unis possèdent la monnaie de référence mondiale, cela n’est pas nécessaire.
Le conflit commercial opposant les États-Unis et la Chine tient le monde en haleine. Récemment, le président américain Donald Trump a annoncé l’introduction d’une surtaxe douanière de 10% sur tous les produits chinois non encore surtaxés, et ce à partir du 1er septembre 2019. Peu de temps après, la banque centrale chinoise a laissé le cours de change entre le yuan renminbi et le dollar franchir le seuil psychologique de 1 à 7. La réaction de Donald Trump ne s’est pas fait attendre: il a qualifié la Chine de «manipulatrice des cours de change». Le conflit prend donc une tournure toujours plus dangereuse.
À première vue, on peut comprendre en partie le malaise des Américains vis-à-vis de leur déséquilibre commercial avec la Chine, car le déficit commercial des États-Unis est effectivement gigantesque. Ceux-ci exportent vers la Chine des marchandises pour une valeur de 130 milliards de dollars par an, et importent pour 530 milliards de dollars environ. Plusieurs explications viennent à l'esprit: la monnaie chinoise est trop faible par rapport au dollar, la Chine pénalise ainsi les importations américaines et subventionne ses exportations. C’est uniquement pour cela que la balance commerciale est déséquilibrée.
Si la balance commerciale entre deux pays devait toujours être à zéro, il ne serait plus possible d’échanger librement des marchandises
La focalisation sur la balance commerciale entre deux pays est problématique pour trois raisons. Premièrement, elle ne couvre pas les services. Or les États-Unis sont très forts pour en vendre dans le monde entier, que ce soit sous forme d’activités de banque d’investissement, de logiciels ou de droits de propriété intellectuelle. Deuxièmement, des distorsions sont possibles dans une balance commerciale, lorsque les indications de provenance ne sont pas correctes ou que des marchandises contiennent une grande part de prestations importées. Ainsi, un iPhone assemblé en Chine est considéré comme un produit chinois à la frontière, indépendamment de la quantité de savoir-faire américain utilisé pour le développer.
La troisième raison est que dans un monde moderne caractérisé par la division du travail les pays se spécialisent dans des domaines différents. Il est donc totalement normal que le pays A affiche un déficit de la balance commerciale par rapport au pays B et qu’il affiche un excédent par rapport au pays C. Cela est inhérent à la mondialisation. Si la balance commerciale entre deux pays devait toujours être de zéro, il ne serait plus possible d’échanger librement des marchandises. Alors il faudrait organiser des marchés pour échanger - vous avez dit «économie planifiée»? - et ainsi échanger, par exemple, un avion contre des tonnes de jouets ou du pétrole contre des montres. La spécialisation, les chaînes de valeur mondiales et donc une allocation efficace des ressources dans la forme actuelle ne seraient plus possibles.
Quand on se focalise sur la balance commerciale bilatérale, on tire des conclusions erronées. En effet, si les critiques à l’encontre de la Chine étaient justifiées, sa balance commerciale afficherait un excédent monstrueux avec le monde entier. Or en 2018, il se montait à 0,4% seulement de son produit intérieur brut. Le Fonds monétaire international (FMI) ne considère plus la Chine comme une des causes des déséquilibres mondiaux. Le yuan renminbi n’est-il d’ailleurs plus si faible? Il est difficile d’établir précisément sa valeur, mais la tendance est claire: selon le FMI, le yuan renminbi s’est apprécié d’un tiers environ, en termes réels, depuis la crise des marchés financiers.
Le dollar domine incontestablement depuis la Deuxième guerre mondiale
Dès lors, il faut chercher ailleurs les explications au déficit de la balance commerciale américaine. Imaginez que, mois après mois, vous dépensiez plus que vous ne gagnez et que vos dettes augmentent progressivement. Vos créanciers ne tarderaient pas à devenir nerveux et à changer de comportement à votre égard. Ce qui vaut pour les particuliers vaut généralement aussi pour les États: si vous vivez au-dessus de vos moyens pendant un certain temps, les créanciers s’inquiètent de votre capacité à rembourser vos dettes. Les taux d’intérêt augmentent et obligent donc les gouvernements à se serrer la ceinture.
Toutefois, les États-Unis possèdent la monnaie de référence mondiale. L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing aurait parlé d’un «privilège exorbitant». Près des deux tiers de toutes les réserves internationales sont détenues en dollars US. Quelque 90% de toutes les transactions effectuées sur les marchés de devises sont réalisées en dollars. Le dollar domine incontestablement depuis la Deuxième guerre mondiale. Ni l’euro ni le yuan renminbi ne peuvent contester son hégémonie. En conséquence, les acteurs des marchés financiers détiennent des dollars, les États fixent leur monnaie au dollar et achètent des dollars à foison lorsque leur monnaie menace de s’apprécier excessivement. Le dollar n’est donc pas seulement la monnaie des États-Unis, mais celle du monde entier.
La vraie raison du déficit élevé de la balance commerciale américaine est toute simple: les États-Unis ont le privilège exorbitant de détenir la monnaie de référence mondiale, ils peuvent donc se permettre de consommer davantage qu’ils gagnent et ce à longueur de décennie. Le dollar reste fort, alors que ce sont les autres pays qui financent la consommation américaine. Dans tout autre pays, la monnaie se trouverait sous pression à long terme, car le déficit de la balance commerciale extérieure doit être compensé par des importations de capitaux, par opposition à la balance des paiements entre deux pays qui doit être équilibrée. Autrement dit, les autres pays doivent être d’accord de couvrir le déficit de la balance commerciale extérieure des États-Unis. Ainsi, les pays ayant un excédent financent les déficits en achetant des emprunts d’États américains ou d’autres actifs aux États-Unis. Ils le font volontairement car le dollar est la monnaie de référence mondiale et qu’il est incontesté.
L’important déficit de la balance commerciale s’explique par des facteurs internes
On ne peut donc pas déclarer la Chine responsable de l’important déficit de la balance commerciale des États-Unis. Celui-ci s’explique par des facteurs internes. Les consommateurs Américains épargnent un peu plus aujourd’hui, mais beaucoup moins que les Chinois: les premiers mettent de côté 7% environ de leur revenu disponible, contre quelque 36% pour les seconds. Quant à l’État américain, il dépense beaucoup plus qu’il n’engrange de recettes. À cela s’ajoute que des baisses d’impôts ont stimulé la conjoncture américaine. Un taux de chômage faible et une économie saine dopent la demande de produits étrangers.
Résorber le déficit de la balance commerciale américaine ne serait pas sorcier: il suffirait que les Américains consomment moins, épargnent plus et que l’État dépense moins. Mais cela n’est même pas nécessaire aussi longtemps qu’ils jouissent du privilège exorbitant de posséder la monnaie de référence mondiale. Le reste du monde va continuer de financer le déficit des États-Unis encore longtemps. D’ailleurs, de nouvelles baisses des taux d’intérêt du côté de la FED ne réduiraient guère le déficit de la balance commerciale. Bien que cette mesure affaiblirait quelque peu le dollar et rendrait les exportations américaines moins chères, la baisse des taux d'intérêt stimulerait également, dans le même temps, la consommation intérieure et donc les importations.
Cette contribution a paru le 31 août 2019 dans le journal alémanique «Finanz und Wirtschaft».